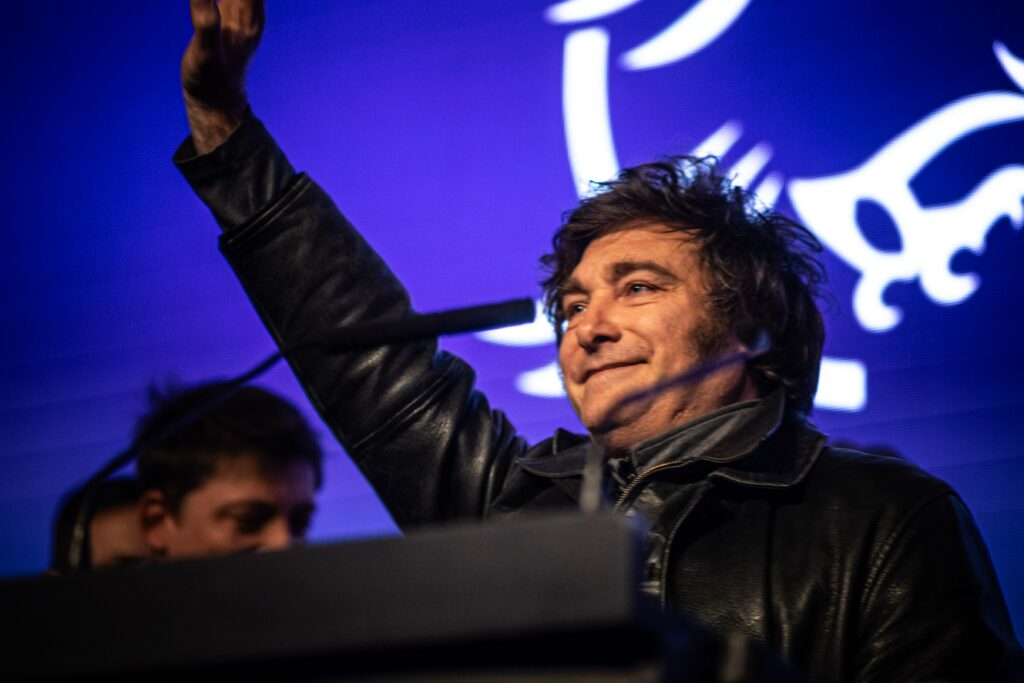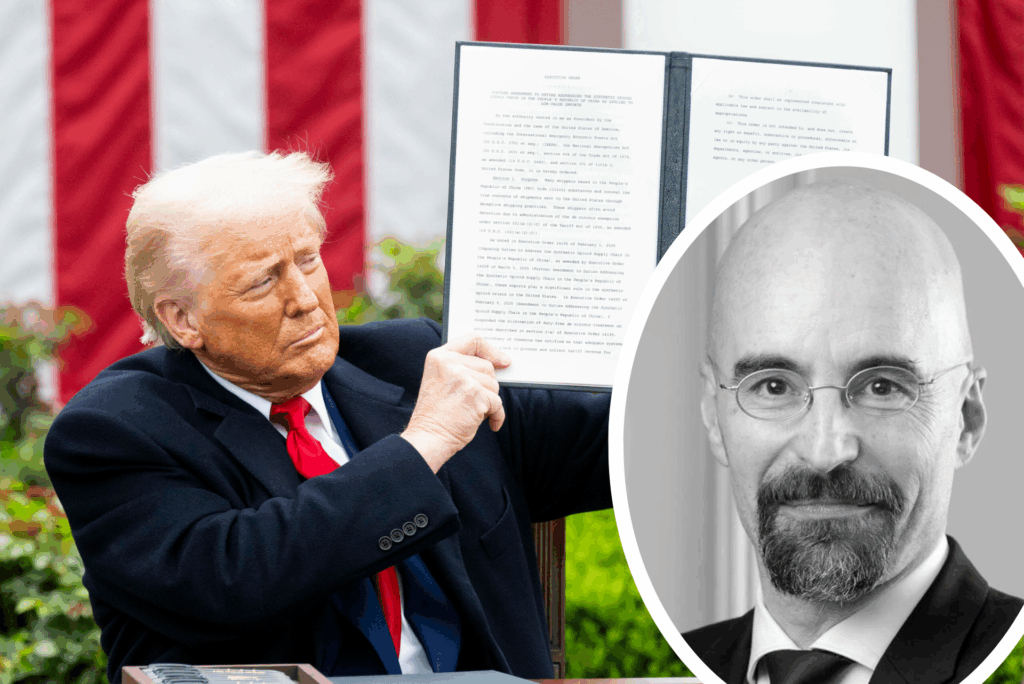L’IA peut-elle faire exploser Wall Street ? (Carte blanche) Partie II

Publié par Contribution Externe
• Mis à jour le
Une carte blanche de Mikael J. K. Petitjean, Chief Economist (Waterloo Asset Management), Professeur des universités (UCLouvain, UGent).
Dans le premier épisode, nous avons montré que, malgré l’ampleur des investissements IA et la hausse des valorisations, les conditions actuelles restent très différentes de celles qui avaient conduit à l’éclatement de la bulle Internet : des multiples certes élevés mais loin des excès de 2000, un financement des CapEx largement assuré par des flux internes plutôt que par la dette, et une dynamique de marché qui reflète davantage une réévaluation de la croissance potentielle qu’une euphorie spéculative.
Dans ce second épisode, nous allons nous concentrer sur ce qui pourrait réellement différencier ce cycle des précédents : l’impact direct de l’IA sur la productivité, la transformation profonde des entreprises, la nature structurelle du cycle d’investissement, et les signaux psychologiques.
Productivité
Troisièmement, même si les statistiques macro ne le montrent pas encore clairement, la montée en puissance de l’IA générative se traduit déjà par des gains de productivité mesurables au niveau micro. Des études académiques récentes sur des centres d’appels montrent qu’un assistant IA de type ChatGPT permet d’augmenter la productivité des agents d’environ 14 %, avec des gains encore plus élevés pour les employés les moins expérimentés. Dans le développement logiciel, des expériences contrôlées autour de GitHub Copilot indiquent que les programmeurs qui utilisent ces outils accomplissent certaines tâches jusqu’à 55 % plus rapidement, à qualité constante ou améliorée.
Ces gains microéconomiques sont cohérents avec les mouvements observés dans les grandes entreprises. Amazon a supprimé environ 27.000 postes de cols blancs en 2022-2023, puis annoncé fin 2025 une nouvelle vague d’environ 14.000 suppressions de postes « corporates », liés aux fonctions centrales, administratives ou de direction, tout en lançant plus de 1.000 projets d’IA et en annonçant des investissements de l’ordre de 10 milliards de dollars dans de nouveaux campus et centres de données axés sur l’IA.
De son côté, Walmart, le plus grand employeur aux États-Unis, a supprimé 1.500 postes « corporates », tout en investissant plus de 500 millions de dollars dans l’IA et la robotisation. L’entreprise vise un taux d’automatisation d’environ 65 % de ses magasins d’ici l’exercice 2026. Son PDG a explicitement indiqué que chacun des 1,6 million d’emplois du groupe sera « transformé » par l’IA, des caissiers jusqu’aux fonctions de direction. Autrement dit, les grands groupes ne se contentent pas de « faire des effets d’annonce » : ils réorganisent en profondeur leur effectif et leurs processus autour de l’automatisation, du cloud et de l’IA.
L’IA n’est pas seulement une histoire de multiples boursiers : elle constitue un levier de productivité et un mécanisme de réallocation du capital et du travail, capable de soutenir les marges et la croissance des bénéfices. De fait, les entreprises américaines affichent aujourd’hui des marges bénéficiaires proches de 14 %, contre 7 % à la sortie de la crise financière en 2009. Dans le reste du monde, ce ratio n’excède pas 10 %. La divergence de rentabilité entre les États-Unis et les autres régions s’est donc non seulement installée mais elle risque de se creuser, portée à la fois par la domination technologique américaine, la montée en puissance de l’IA et un environnement d’affaires plus favorable à l’investissement et à l’innovation.
Un cycle d’investissement structurel
Quatrièmement, les investissements liés à l’IA répondent à un besoin structurel bien plus profond qu’un simple effet de mode. L’économie migre vers des modèles beaucoup plus intensifs en calcul, ce qui impose un cycle d’investissement en infrastructures comparable à celui qui avait accompagné la montée en puissance du cloud entre 2010 et 2015. Les entreprises doivent financer, sur plusieurs années, la construction de centres de données beaucoup plus puissants, l’achat massif de GPU et de puces spécialisées, la modernisation des réseaux de télécommunication ainsi que le renforcement des capacités électriques, aujourd’hui proches de la saturation dans plusieurs régions. À cela s’ajoutent des besoins nouveaux en matière de logiciels d’orchestration, de sécurité et de gestion des modèles. L’ensemble forme un mouvement d’investissement qui dépasse largement une logique spéculative : il conduit à bâtir une infrastructure technologique adéquate pour que l’IA puisse réellement se déployer à grande échelle dans l’économie réelle.
Le pessimisme ambiant
Enfin, un autre élément ne doit jamais être oublié : le pessimisme paie très rarement. Après quatre ans d’alertes sur « la récession la plus anticipée de l’histoire » aux États-Unis, qui n'est jamais venue, les marchés pourraient être témoins d’un phénomène similaire : « l’implosion de la tech la plus prédite de l’histoire » qui, elle non plus, pourrait ne jamais se produire.
Nous considérons la « une » très pessimiste de The Economist publiée cette semaine, intitulée « Comment les marchés pourraient faire basculer l'économie », comme un signal classique : quand le pessimisme atteint la couverture d’un grand magazine, le marché est souvent plus proche d’un creux que d’un sommet. Et il ne faut jamais oublier le conseil de Sir John Templeton, l’un des plus grands investisseurs du 20ème siècle, célèbre pour son approche « contrarienne » et pour avoir bâti le premier fonds d’investissement véritablement mondial : « la seule façon d'éviter les erreurs est de ne pas investir, ce qui est la plus grande erreur qui soit ».
Perspectives
C’est dans cet esprit que nous avions relevé en septembre à 7.000 points notre objectif pour le S&P 500, contre 6 .600 points en janvier. Nous maintenons l’objectif à 7.000 points et pensons qu’un scénario de hausse durable de la productivité est plus plausible qu’un remake de l’écroulement technologique de 2000. Dans le pire des cas, la clé est toujours de prévoir d’allonger son horizon d’investissement en cas de coup dur.
Le véritable risque
De notre point de vue, un point de vigilance demeure l’élargissement de la hausse des cours. Il faut rappeler que les entreprises du S&P 500 sont réparties en 11 secteurs, mais qu’en pratique 44 % de la capitalisation boursière et 37 % des bénéfices attendus proviennent de seulement deux d’entre eux : la technologie et les services de communication.
La comparaison avec l’an 2000 nuance néanmoins ce risque. À l’époque, ces deux secteurs affichaient un poids boursier comparable, mais ne généraient que 24 % des bénéfices du S&P 500. L’écart entre valorisation et profits était donc près de trois fois plus important qu’aujourd’hui. Autrement dit, la concentration actuelle reflète surtout le poids économique désormais central des grandes plateformes technologiques, dont la capitalisation s’appuie sur une contribution aux bénéfices bien plus substantielle qu’à l’époque des dotcoms.
Par ailleurs, plusieurs signes d’élargissement apparaissent : les banques se redressent, certains segments industriels retrouvent de l’intérêt, et la dispersion sectorielle commence à se stabiliser. Pour que cet élargissement devienne réellement durable, il faudrait toutefois un regain plus marqué dans les secteurs encore sous-pondérés, en particulier l’énergie, la santé et la consommation de base. Sans une participation plus franche de ces compartiments défensifs, il sera plus difficile de reproduire la performance de 2025.
Mikael J. K. Petitjean, Chief Economist (Waterloo Asset Management), Professeur des universités (UCLouvain, UGent)