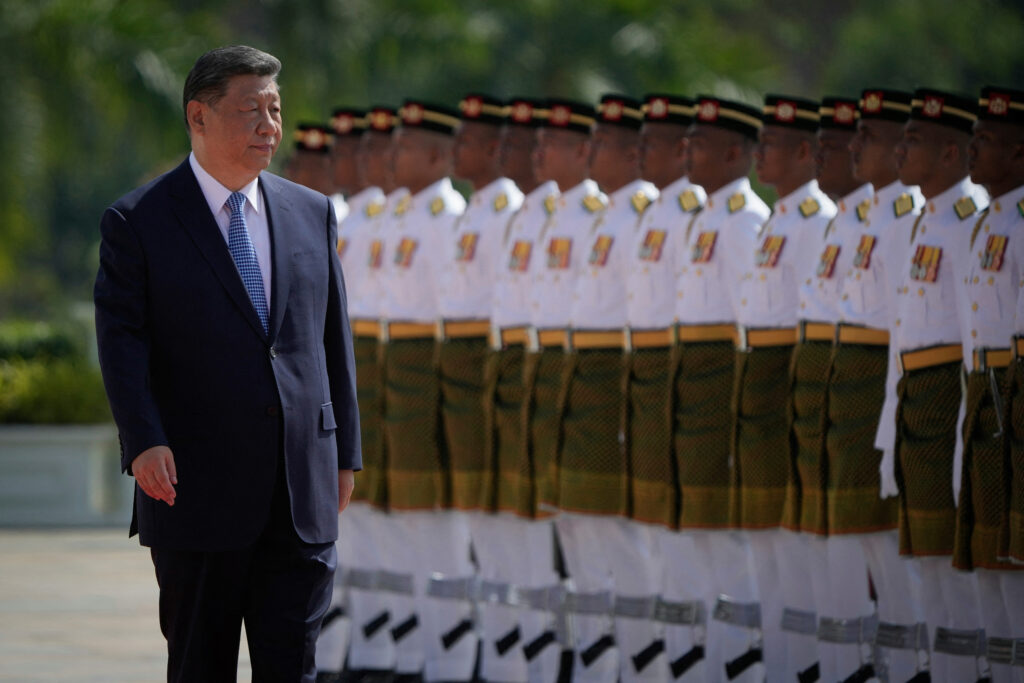Bernard Lugan allègue que le Sahara occidental est purement marocain

Publié par Harrison du Bus
• Mis à jour le
Sommaire
- La colonisation, une amputation du royaume
- Une question existentielle plus qu’économique
- Le gazoduc Nigeria–Maroc, colonne vertébrale du futur
- Le Maroc, modèle d’État stable et légitime
- Face à l’Algérie : deux visions du Maghreb
- Un Sahara pivot d’équilibres internationaux
- Les limites et les critiques de cette thèse
- Une conviction qui dépasse la géographie
- Un historien engagé dans la durée
- En conclusion
Pour l’historien et africaniste Bernard Lugan, la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental n’est pas une revendication récente mais le prolongement d’une continuité pluriséculaire. Dans ses ouvrages et ses interventions, il voit dans la récupération de ces « provinces du Sud » la clef de la cohérence territoriale du royaume.
Une lecture à rebours des récits indépendantistes et des positions algériennes, où se mêlent géopolitique, mémoire coloniale et conception monarchique de l’unité nationale – lecture qu’il a partagée à la Revue Conflits dont nous discernons des conclusions tranchées mais marquées d’une rare érudition.
Pour Bernard Lugan, comprendre la question saharienne suppose d’abord de comprendre ce qu’est le Maroc lui-même. Il cite volontiers la phrase du roi Hassan II : « Le Maroc est un arbre dont les racines plongent dans le fleuve Sénégal et dont les feuilles bruissent au détroit de Gibraltar. »
L’image n’est pas poétique mais géopolitique : le Maroc, selon lui, fut historiquement un royaume dont l’influence s’étendait du Sahel à l’Andalousie, de Tombouctou à Saragosse. Les empires almoravide, almohade ou saadien auraient administré, directement ou par allégeance tributaire, la majeure partie du Sahara atlantique.
Cette profondeur méridionale donnerait au Maroc une identité différente de celle de ses voisins.
Lugan oppose ainsi un royaume ancien, à la monarchie continue, à une Algérie née de la colonisation française et structurée tardivement. Le Maroc, soutient-il, a connu des dynasties successives mais un État permanent, là où d’autres régions d’Afrique du Nord ont connu des discontinuités politiques.
Cette permanence monarchique justifie dans son raisonnement que le Maroc puisse revendiquer un droit historique sur ses confins méridionaux.
La colonisation, une amputation du royaume
La matrice de son argumentation est claire : la colonisation aurait dépecé un État pré-existant.
Selon Lugan, les puissances européennes du XIXᵉ siècle – la France à l’est, l’Espagne au sud – auraient détaché du Maroc des zones entières : le Tindouf actuel et une partie de l’Ouest algérien côté français ; le Sahara occidental côté espagnol. La création de l’Algérie coloniale aurait donc amputé le royaume chérifien d’une part de ses territoires historiques, et la colonie espagnole du Sahara ne serait que la seconde phase d’un même morcellement.
Dans cette perspective, la marocanité du Sahara occidental ne découle pas de la conquête post-coloniale, mais d’une continuité interrompue que Rabat aurait cherché à restaurer. Lugan ne parle d’ailleurs jamais d’« annexion », mais de « récupération » : il considère les provinces du Sud comme intégrées au corps du Maroc depuis toujours, leur détachement n’étant qu’une parenthèse coloniale. Cette lecture fait du retour du Sahara sous souveraineté marocaine un acte de réparation historique, non une expansion territoriale.
Une question existentielle plus qu’économique
Pourquoi ce territoire quasi désertique serait-il si vital ? Parce qu’il touche, selon lui, à la définition même du royaume. Sans le Sahara, le Maroc ne serait qu’un « petit pays du Nord du Maghreb ». La récupération des provinces du Sud redonne au pays sa dimension atlantique et sahélienne, celle d’une puissance de liaison entre le Maghreb et l’Afrique de l’Ouest.
Contenu Premium
Pour continuer la lecture, abonnez-vous ou utilisez un crédit.
Deja abonne ? Se connecter