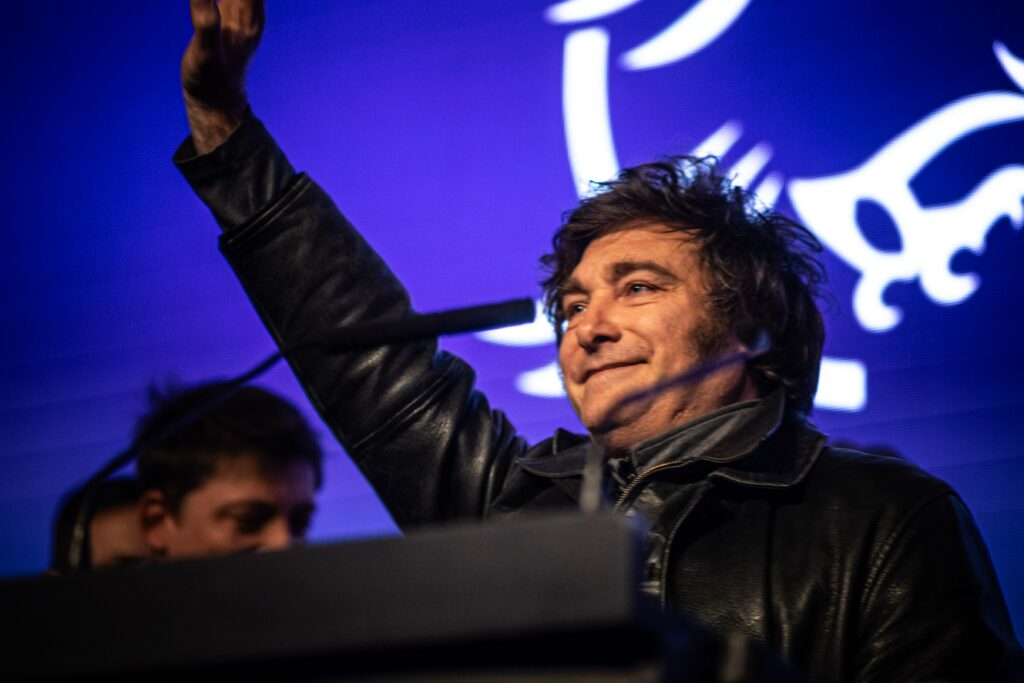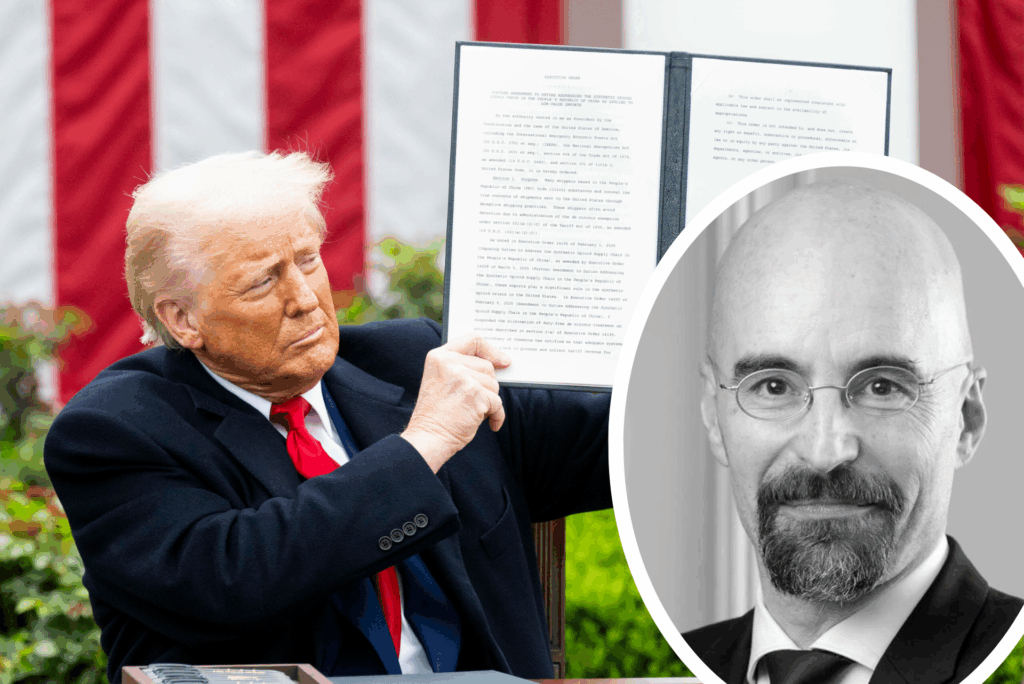L’IA peut-elle faire exploser Wall Street ? (Carte blanche) Partie I

Publié par Contribution Externe
• Mis à jour le
Une carte blanche de Mikael J. K. Petitjean, Chief Economist (Waterloo Asset Management), Professeur des universités (UCLouvain, UGent).
L’indice S&P 500 progresse d’environ 14 % depuis le début de l’année, une hausse largement tirée par des géants technologiques. Il ne s’agit pourtant pas d’une performance exceptionnelle, puisque l’indice a fait mieux dans 40 % des cas depuis 1928. L’attention des médias et des investisseurs ne porte d’ailleurs pas tant sur la hausse en elle-même mais sur l’ampleur des investissements consentis dans l’intelligence artificielle et sur sa trajectoire future. Jusqu’où ce cycle d’expansion peut-il durer, et à partir de quel point bascule-t-on d’un régime de croissance structurelle à un risque de surchauffe ?
Indubitablement, les « hyperscalers », comme Amazon (AWS), Microsoft (Azure) et Google (Google Cloud), investissent des montants colossaux dans les data centers, au risque d’une surcapacité réelle si la demande ne suit pas. Dans le même temps, des acteurs spécialisés comme CoreWeave ont chuté en Bourse. Non par manque de demande, mais parce que la construction des centres de données prend du retard en raison de pénuries d’électricité, de délais de raccordement et de contraintes administratives locales qui ralentissent l’expansion des sites.
« Si certains segments de la technologie sont chers, les valorisations actuelles n’atteignent en rien les niveaux extravagants de la bulle Internet. »
Incontestablement, une partie de la demande actuelle s’explique par la puissance de calcul nécessaire à l’entraînement des grands modèles, et non par l’utilisation finale qu’en feraient les entreprises ou les consommateurs. C’est une distinction essentielle pour juger de la pérennité du cycle.
À juste titre, Michael Burry, célèbre pour avoir misé sur la crise des « subprimes », a accusé les « hyperscalers » de sous-estimer la durée de vie économique de leurs GPU : selon lui, ces puces ultraspécialisées devraient être amorties sur 2 à 3 ans, ce qui alourdirait sensiblement les charges et réduirait artificiellement les bénéfices affichés. Son argument renvoie à une réalité technique : la génération des GPU se renouvelle désormais à un rythme annuel ou bisannuel, ce qui rend obsolètes les pratiques comptables héritées d’une époque où la durée de vie utile dépassait 5 ans.
Toutes ces questions sont légitimes et reflètent une prudence croissante mais ces signaux d’alerte sont-ils suffisants pour annoncer l’éclatement d’une bulle ?
Des valorisations élevées, mais sans commune mesure avec la bulle de 2000
Les valorisations ont indiscutablement progressé. Le ratio cours/bénéfices du S&P 500 est passé d’environ 20 à près de 23 en moins de deux ans, porté avant tout par les valeurs technologiques. Un simple retour à un multiple de 21, sans modification des anticipations de bénéfices, impliquerait mécaniquement une correction des cours de l’ordre de 15 %, toutes choses égales par ailleurs. Autrement dit, la hausse récente repose en partie sur une expansion des valorisations qui pourrait s’inverser si le contexte de taux, de bénéfices ou de sentiment venait décevoir.
Un examen attentif des niveaux actuels montre pourtant que la situation actuelle ne peut être comparée aux excès de la « dotcom mania ». Au sommet du marché, le 24 mars 2000, les grandes valeurs américaines affichaient des ratios cours/bénéfices prévisionnels sans commune mesure avec ceux observés aujourd’hui. Intel se traitait alors autour de 47 fois les bénéfices attendus, tandis que Microsoft dépassait 60 fois les bénéfices. Les excès les plus flagrants concernaient les stars de l’époque : Oracle se valorisait à plus de 120 fois les bénéfices futurs et Cisco culminait à plus de 130 fois, des niveaux caractéristiques d’une réelle euphorie spéculative.
En comparaison, les valorisations actuelles restent nettement plus mesurées. Google se situe autour de 25 fois les bénéfices attendus, Nvidia autour de 31 fois, Apple et Microsoft autour de 32 fois. Ces multiples sont certes élevés par rapport à leurs moyennes historiques, mais ils reflètent surtout une révision haussière de la croissance bénéficiaire attendue et non une déconnexion totale entre prix et fondamentaux.
Si certains segments de la technologie sont chers, les valorisations actuelles n’atteignent en rien les niveaux extravagants de la bulle Internet. Le contraste entre les deux périodes suggère qu’on se trouve davantage dans une phase de réévaluation de la croissance potentielle que dans une bulle spéculative comparable à celle des années 2000.
Le financement des CapEx
Deuxièmement, les géants technologiques financent pour l’essentiel leurs dépenses investissements (CapEx) à partir de flux de trésorerie internes, sans recourir à un endettement important. Au niveau microéconomique, les chiffres récents sont assez explicites : au troisième trimestre 2025, Alphabet a engagé environ 24 milliards de dollars de CapEx, soit 49 % de son cash-flow opérationnel (CFO). Chez Meta et Microsoft, ce ratio « CapEx/CFO » atteint respectivement 64,6 % et 77,5 %. Pour l’ensemble des cinq principaux hyperscalers, près de 60 % des flux de trésorerie opérationnels est aujourd’hui réinvesti dans les infrastructures IA (GPU, data centers, réseaux). Malgré l’intensité exceptionnelle de ces investissements, ils restent principalement autofinancés, ce qui limite l’effet de levier et distingue clairement la période actuelle d’un cycle de bulle financée par la dette.
Entre les années 1970 et l’an 2000, les entreprises américaines consacraient en moyenne près de 89 % de leurs flux internes à l’investissement fixe1. À l’approche de l’an 2000, les entreprises américaines finançaient donc déjà une très grande part de leurs dépenses d’investissement par leurs flux internes. Ensuite, ils n’ont pas suffi face à la frénésie d’investissement liée à la « dotcom mania ». Ils ont été complétés par de la dette, souvent sur la base de projections de croissance irréalistes. Lorsque la rentabilité attendue de ces investissements s’est effondrée, cette combinaison, entre forte intensité d’investissement et recours accru à la dette, a rendu le système particulièrement vulnérable.
La phase actuelle de surinvestissement dans l’IA se déroule dans un environnement très différent. Aujourd’hui, malgré l’ampleur spectaculaire des « CapEx » dans les « Big Tech », les ratios « CapEx/CFO » restent inférieurs aux excès de 1999–2000 et le recours au levier financier moins extrême qu’à la veille de l’éclatement de la bulle internet.
Au total, l’effort d’investissement dans l’IA est bel et bien massif mais il s’inscrit dans une trajectoire financière plus soutenable car il est moins dépendant de la dette et mieux adossée à des capacités d’autofinancement. Cela ne supprime évidemment pas le risque : la clé reste la capacité des investissements à générer les retours promis.
Mais pour comprendre si Wall Street se trouve réellement au bord d’une surchauffe, il faut aller au-delà des seules valorisations et examiner deux forces déterminantes : les gains de productivité liés à l’IA et la nature profondément structurelle du cycle d’investissement en cours. C’est à la lumière de ces éléments que nous pourrons analyser le risque véritable et préciser nos perspectives de marché. Ce sera l’objet de l’Épisode II.
Mikael J. K. Petitjean, Chief Economist (Waterloo Asset Management), Professeur des universités (UCLouvain, UGent)
(Photo :
- Dans les comptes nationaux (NIPA), le cash-flow interne des entreprises non financières, défini comme profits non distribués + amortissements + inventory valuation adjustment – dividendes nets, mesure la capacité d’autofinancement de l’ensemble du secteur. ↩︎