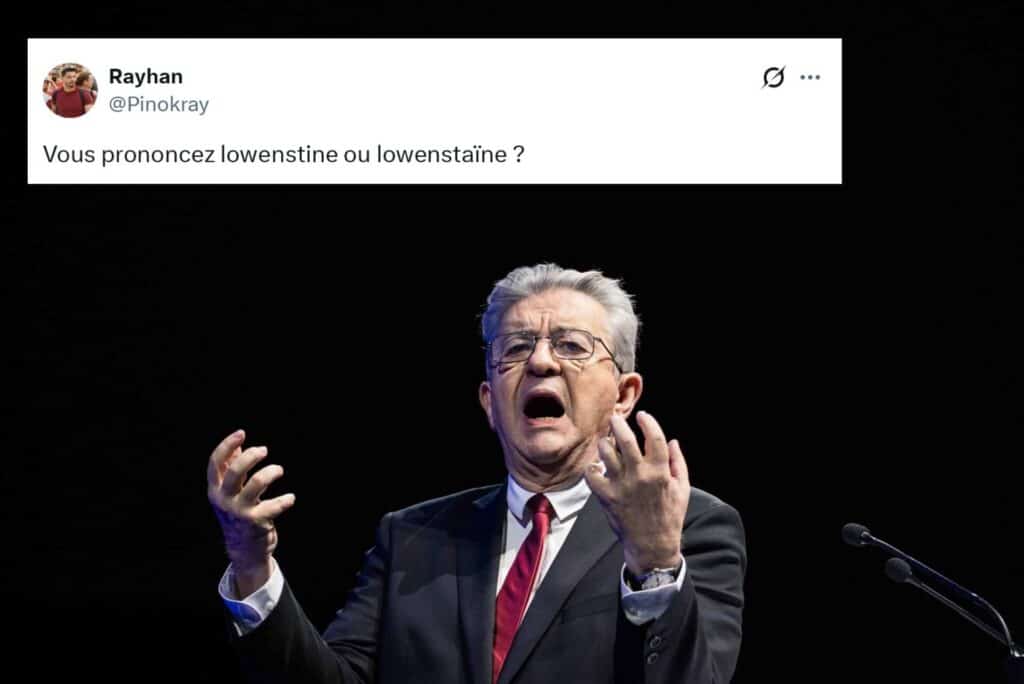L’ingratitude des repus - Ou comment cultiver la gratitude pour le progrès (Maarten Boudry - Carte blanche)

Publié par Contribution Externe
• Mis à jour le
Lorsque je pense à la chaîne ininterrompue de générations qui nous a conduits jusqu’à aujourd’hui et à tout ce qu’elles ont bâti pour nous, je suis saisi d’humilité. Je suis submergé de gratitude, stupéfait par l’ampleur de l’héritage et par l’impossibilité de rendre ne fût-ce qu’une infime partie de la pareille.
— Toby Ord, The Precipice
Le progrès est notre échappatoire au statu quo de la souffrance, notre siège éjectable hors de l’histoire.
— Derek Thompson, The Atlantic
Dans mon essai pour Quillette, « The Enlightenment’s Gravediggers », j’examinais le phénomène curieux de l’auto-dénigrement anti-occidental comme un effet du côté de l’offre. Les gens aiment se plaindre de leur vie partout dans le monde (côté demande), mais seules les sociétés libres offrent en abondance la possibilité de le faire en toute impunité (côté offre). En raison de cette asymétrie, les sociétés libres deviennent victimes de leur propre succès et s’exposent à une autocritique incessante, bien plus que les sociétés non libres.
Mais il existe un sens plus littéral encore dans lequel la modernité nourrit ses propres critiques. Lorsque le philosophe français Jean-Jacques Rousseau rédigeait ses diatribes contre la quête du savoir, la science n’avait pas encore apporté de bénéfices tangibles aux gens ordinaires. Au XVIIᵉ siècle, des visionnaires comme Francis Bacon prédisaient que l’accumulation des connaissances améliorerait un jour la condition humaine. Pourtant, à l’époque, la majorité vivait dans une pauvreté extrême, les enfants mouraient en masse, les paysans dépendaient de la force musculaire et des animaux de trait, et même le plus riche des rois pouvait succomber à une infection bénigne aujourd’hui traitée par des antibiotiques bon marché, pris en charge par les assurances.
À partir du milieu et de la fin du XIXᵉ siècle, la main de la modernité industrielle commença toutefois à nourrir tout le monde à un coût toujours plus faible. Ce surplus alimentaire créa à son tour de nouvelles opportunités pour des intellectuels qui firent carrière en la mordant (encore le côté offre). L’un des exemples les plus anciens et les plus célèbres est Karl Marx. Tandis qu’il fustigeait les maux du capitalisme dans de volumineux ouvrages, Marx survivait grâce aux subsides de son riche camarade Friedrich Engels, dont la fortune provenait des filatures de coton de son père à Manchester. Autrement dit, Marx vivait des profits mêmes du système capitaliste qu’il dénonçait. Comme l’a résumé l’historien Niall Ferguson dans Civilization: The West and the Rest (2011) : « Aucun homme dans l’histoire n’a mordu avec autant d’enthousiasme la main qui le nourrissait que Marx n’a mordu celle du roi Coton. »
Au moins Marx reconnaissait-il aussi les accomplissements du capitalisme bourgeois et de la modernité dans son ensemble — il pensait simplement qu’il s’agissait d’une phase transitoire de l’histoire humaine. Mais à mesure que les sociétés devenaient plus prospères et s’habituaient à l’abondance, elles commencèrent à oublier la misère dont leurs ancêtres s’étaient extraits. C’est ainsi qu’est né un phénomène typiquement moderne : s’abandonner à des fantasmes romantiques sur les bienfaits d’une vie primitive et pré-moderne, sans renoncer pour autant aux nourritures et aux conforts offerts par la modernité.
L’un des premiers praticiens de cette hypocrisie fut peut-être le philosophe et naturaliste américain Henry David Thoreau. Dans son ouvrage célèbre Walden, Thoreau décrit la vie qu’il mena en ermite dans une modeste cabane en pleine nature, donnant l’impression d’une autosuffisance totale et d’une coupure radicale avec la civilisation. En réalité, il lui suffisait de vingt minutes à pied pour rejoindre sa maison familiale à Concord depuis l’étang de Walden — un trajet qu’il effectuait régulièrement pour dîner avec des amis et savourer les biscuits que sa mère préparait à partir de sucre et de farine produits industriellement.
L’étang de Walden n’avait rien d’une « wilderness ». En été, le lieu grouillait de pique-niqueurs et d’excursionnistes ; en hiver, il se remplissait de patineurs et de coupeurs de glace. Thoreau recevait fréquemment la visite de sa sœur et de ses amis, et organisait des rassemblements réunissant jusqu’à trente personnes, qui lui apportaient des provisions en quantité indéterminée. Cet intellectuel fortuné, diplômé de Harvard, s’appuyait aussi sur les presses d’imprimerie industrielles et sur les réseaux de transport modernes pour diffuser à grande échelle ses sermons puritains contre la civilisation.
Vous ne pouvez pas comprendre la pauvreté
Dans le classique britpop de Pulp, « Common People », une étudiante en art privilégiée issue d’une riche famille grecque (que l’on dit être aujourd’hui l’épouse de l’économiste radical de gauche Yanis Varoufakis) demande au chanteur issu de la classe ouvrière ce que cela fait vraiment de vivre comme les « gens ordinaires ». La chanson est une critique mordante de ce que nous appellerions aujourd’hui le tourisme de la pauvreté. « Fais comme si tu n’avais pas d’argent », commence sèchement Jarvis Cocker, avant de décrire la vie dans un logement délabré et l’angoisse de boucler les fins de mois. Mais la jeune femme semble trouver tout cela amusant, et Cocker finit par désespérer : elle ne comprendra jamais vraiment.
But still you’ll never get it right,
’Cause when you’re laid in bed at night,
Watching roaches climb the wall,
If you called your dad he could stop it all.
Peut-on réellement comprendre la pauvreté sans l’avoir vécue ? Même le narrateur de cette chanson aurait du mal à saisir ce que signifie la pauvreté absolue telle que définie par la Banque mondiale - la condition misérable dans laquelle vivait la quasi-totalité de l’humanité avant 1800. Nous devrions tous être reconnaissants de ne jamais comprendre la pauvreté. Mais cette ignorance constitue un terreau fertile pour les illusions romantiques. Des millions d’Occidentaux repus s’extasient sur la vie simple des paysans médiévaux (pas de smartphones ! des légumes bio du jardin !) ou sur l’existence nomade des chasseurs-cueilleurs (pas de possessions matérielles ! vivre en harmonie avec la nature !). Ceux qui vantent l’agriculture préindustrielle sans engrais ni tracteurs mécanisés sont précisément ceux qui n’ont jamais dû en vivre.
Il faut un universitaire privilégié du XXIᵉ siècle, adepte de la décroissance comme Jason Hickel, pour imaginer que les paysans de subsistance du Moyen Âge étaient « plutôt heureux », jouissant de « communs abondants » et n’ayant jamais à travailler pour un salaire. Et il faut une militante climatique bien nourrie comme Greta Thunberg, dans une maison bien chauffée remplie de produits fossiles - le ciment des murs, l’acier des poutres, l’aluminium des ordinateurs portables, les centaines de plastiques des appareils et des vêtements, la nourriture des réfrigérateurs, la colle avec laquelle elle se fixe aux tableaux - pour donner des leçons au monde sur son « addiction » aux énergies fossiles. La modernité industrielle produit les calories qui nous permettent de nous adonner à de telles fantaisies anti-modernes, comme l’a observé l’économiste Noah Smith :
Le ventre plein de sucres cultivés industriellement, ils errent dans de douces fantaisies d’un passé imaginaire - des mondes pastel peuplés de nobles sauvages, de paysans heureux et indolents, et de publicités rutilantes des années 1950.
Dans une société capitaliste, plus le surplus de production est important, plus il existe d’opportunités de carrière pour des intellectuels anticapitalistes qui se complaisent dans ces fantasmes, certains que des milliers de machines éprouvées par le marché satisferont leurs besoins matériels, et qu’ils pourront vendre librement leurs pamphlets anticapitalistes en librairie, en concurrence ouverte avec d’autres auteurs anticapitalistes.
L’invisibilité du progrès
Certaines bénédictions de la modernité sont si évidentes que même les grincheux les plus endurcis doivent les reconnaître à contrecœur. Dans Straw Dogs (2003), le pessimiste invétéré John Gray admettait déjà que les toilettes à chasse d’eau et l’anesthésie dentaire constituent des « bienfaits sans mélange » de la vie moderne. Lorsque des universitaires anti-modernes idéalisent les époques passées depuis le confort de leurs amphithéâtres chauffés, je soupçonne une part de mauvaise foi. Peu de gens accepteraient réellement d’entrer dans une machine à remonter le temps pour échanger leur vie actuelle contre celle d’une époque antérieure.
Le progrès, cependant, efface ses propres traces. Les vaccins fonctionnent si bien que nous oublions à quel point les maladies qu’ils ont presque éradiquées étaient terribles. La nourriture est devenue si abondante et bon marché que nous ne comprenons plus ce que signifie mourir de faim. La paix et la prospérité sont devenues si normales que nous oublions que la pauvreté et la guerre furent la norme durant la majeure partie de l’histoire humaine.
Nous sommes tous un peu comme les petits poissons de l’histoire de David Foster Wallace qui se demandent : « L’eau ? C’est quoi ça ? Jamais entendu parler. » La machine infiniment complexe de la modernité industrielle ronronne en permanence en arrière-plan, silencieuse et invisible - jusqu’au moment où quelque chose se casse et qu’il faut appeler le plombier. Comme le note l’ingénieure Deb Chachra dans How Infrastructure Works, une bonne définition de l’« infrastructure » est simplement « tout ce à quoi vous ne pensez pas ».
D’un geste du doigt sur un mur, nous contrôlons d’immenses turbines situées à des dizaines de kilomètres, envoyant instantanément un flux d’électrons dans nos salons. D’un autre geste, nous faisons jaillir une eau propre et chimiquement purifiée, régulièrement inspectée par des autorités bienveillantes. En quelques clics, nous mobilisons un colosse mondial qui livre nos objets favoris par des porte-conteneurs géants. Et d’une simple pression sur un bouton, nos déchets corporels disparaissent de notre vue, acheminés par des réseaux d’égouts et des stations d’épuration complexes, afin que nous n’ayons plus jamais à y penser.
Un exemple modeste mais frappant de cette invisibilité du progrès nous vient de Hans Rosling. Lors d’une visite dans un hôpital privé au Kerala, en Inde, son groupe attendait l’ascenseur lorsqu’une étudiante en retard accourut et glissa sa jambe pour empêcher les portes de se refermer. Mais les portes ne se rouvrirent pas : elles écrasèrent sa jambe et l’ascenseur commença à monter. Heureusement, l’hôte indien appuya sur le bouton d’urgence. Se tournant vers Rosling, il déclara : « Je n’ai jamais vu ça. Comment pouvez-vous admettre des gens aussi stupides en médecine ? » Elle n’était pourtant pas stupide : elle supposait naïvement que tout ascenseur est équipé d’un capteur empêchant la fermeture des portes. J’aurais pu commettre la même erreur.
Même si nous tentons de nous rappeler les bienfaits invisibles de la modernité, nous continuerons à les sous-estimer. Vous pouvez contempler les graphiques d’Our World in Data sur le recul de la pauvreté et des maladies jusqu’à en devenir bleu, cela reste un savoir abstrait qui ne s’imprime jamais totalement. Les horreurs dont nous nous sommes affranchis sont presque inconcevables.
Que faire ?
La guerre en Ukraine a rappelé aux Européens le privilège de vivre sans conflit et le succès remarquable du projet européen dans l’élimination des guerres entre États européens. Mais nous n’allons pas déclencher une guerre de temps à autre simplement pour rappeler la valeur de la paix.
Certaines émissions tentent de recréer la vie avec les technologies primitives d’autrefois, comme la série de la BBC Living in the Past (1978), ou Tales from the Green Valley (2005). Dans The Techno-Humanist Manifesto, Jason Crawford propose une « alphabétisation industrielle » incluant des expériences pratiques de la vie préindustrielle.
Mais, comme l’a noté Michael Magoon, si l’on voulait vraiment recréer la vie passée, les participants seraient chroniquement sous-alimentés, infestés de parasites, avec des dents pourries, transis de froid, vivant dans des odeurs insoutenables et voyant mourir la moitié de leurs enfants. Rien de tout cela n’est montrable à la télévision. Il ne s’agit que de tourisme de la pauvreté.
Cultiver la gratitude
J’ai grandi catholique en Flandre. Bien que je sois athée depuis trente ans, j’ai conservé une valeur morale : la gratitude pour les bienfaits de la vie. Avant chaque repas, nous remerciions le Seigneur pour la nourriture sur la table. J’ai gardé cet esprit de gratitude, que beaucoup semblent avoir perdu aujourd’hui.
Le philosophe Daniel Dennett l’a magnifiquement exprimé dans son essai « Thank Goodness », écrit après une opération à cœur ouvert, où il remerciait la médecine moderne, les soignants et les systèmes de santé. Sans eux, je n’aurais jamais rencontré Dennett ni bénéficié de son mentorat.
Si vous êtes non-croyant et ne ressentez aucune obligation de remercier une entité surnaturelle pour votre nourriture, pourquoi ne pas remercier plutôt l’ingéniosité humaine, comme une forme de prière laïque - les inventeurs des chaînes de montage, des engrais artificiels, des moteurs diesel et des porte-conteneurs ? Remerciez la main invisible du marché plutôt qu’un créateur invisible. Comme l’écrit Michael Magoon :
"Approfondir notre compréhension de la manière dont nos ancêtres ont créé le progrès et l’ont entretenu peut nous donner un sentiment de gratitude. Nos ancêtres ont travaillé très dur, et nous sommes tous les bénéficiaires de leurs efforts."
Regardez une pile d’ananas ordinaires au supermarché avec les yeux de quelqu’un des siècles passés. Il n’y a pas si longtemps, comme l’écrit Étienne Fortier-Dubois, les ananas étaient une curiosité exotique en Europe, si chers qu’ils étaient exposés comme des objets de luxe plutôt que consommés, ou même loués à l’heure. Pendant un temps, il y eut même une véritable mode de l’ananas chez les architectes, la forme du fruit servant à « décorer tout, des trophées sportifs aux cathédrales ». Aujourd’hui, nous sommes devenus si blasés face aux ananas que nous les achetons déjà découpés dans des salades de fruits, à peine conscients de leur présence.
Encore en 1989, Boris Eltsine, en visite aux États-Unis dans le cadre d’une délégation soviétique, a visité un supermarché Randalls à Houston, au Texas, et en a été profondément bouleversé. L’abondance, la diversité et les prix accessibles de cette nourriture l’ont sidéré. Rien de tel n’existait à Moscou, marquée par la pénurie et les longues files d’attente pour se nourrir.
Dans sa biographie ultérieure, Eltsine est revenu sur cette expérience qui a changé sa vie :
"Lorsque j’ai vu ces rayons débordant de centaines, de milliers de boîtes, de cartons et de marchandises de toutes sortes, j’ai ressenti pour la première fois, très franchement, un profond malaise mêlé de désespoir pour le peuple soviétique. Qu’un pays potentiellement aussi riche que le nôtre ait été amené à un tel état de pauvreté ! C’est terrible d’y penser."
On peut supposer que ce choc a fini par s’estomper, même pour Eltsine, après la chute du Mur. Mais avec un peu d’imagination, nous pouvons regarder les rayons des supermarchés à travers les yeux de Boris Eltsine et éprouver une gratitude durable envers la technologie moderne et le capitalisme.
Maarten Boudry, philosophe et auteur
Références
Les nombreuses références de cet essai sont à retrouver dans l’édition originale : The Ingratitude of the Well-Fed
(Photo : Tim Deschaumes / Wikimedia Commons – CC BY 3.0)