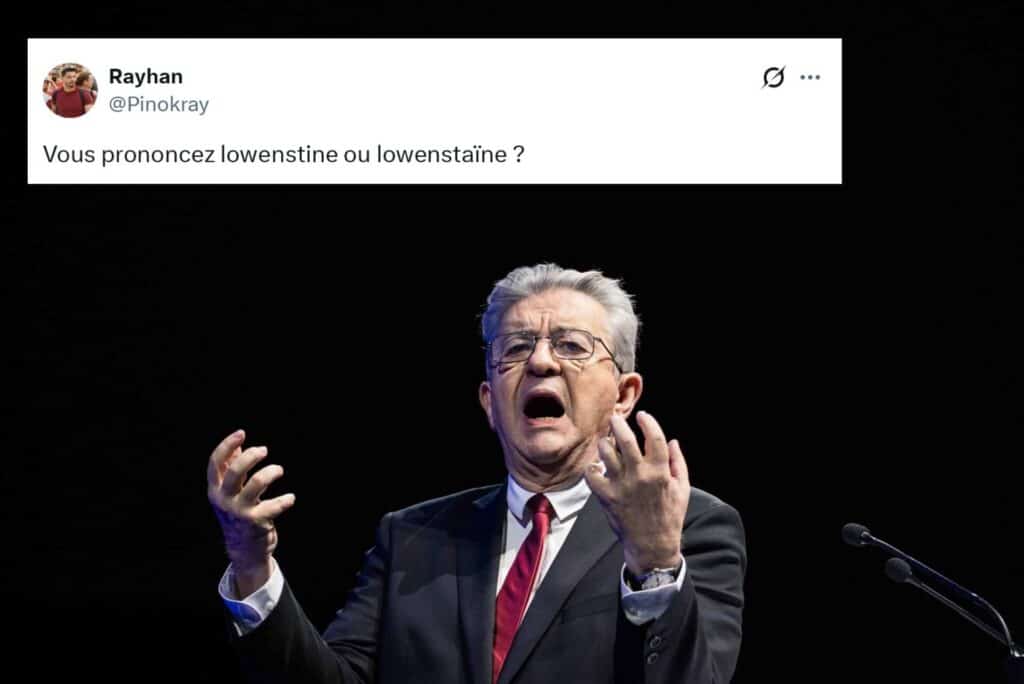Rojava : l’allié abandonné et la myopie stratégique européenne (carte blanche)
Les crises contemporaines ont ceci de particulier qu’elles saturent le champ de vision et empêchent de discerner les lignes profondes. C’est dans ces angles morts que se jouent pourtant les rapports de puissance réels. Le nord-est syrien, au Rojava, en est aujourd’hui l’illustration la plus frappante : alors que l’opinion occidentale oscille entre Gaza, l’Ukraine, Taïwan ou le Sahel, une opération militaire et politique visant à effacer un acteur central de la guerre contre l’État islamique se déploie presque sans témoin.